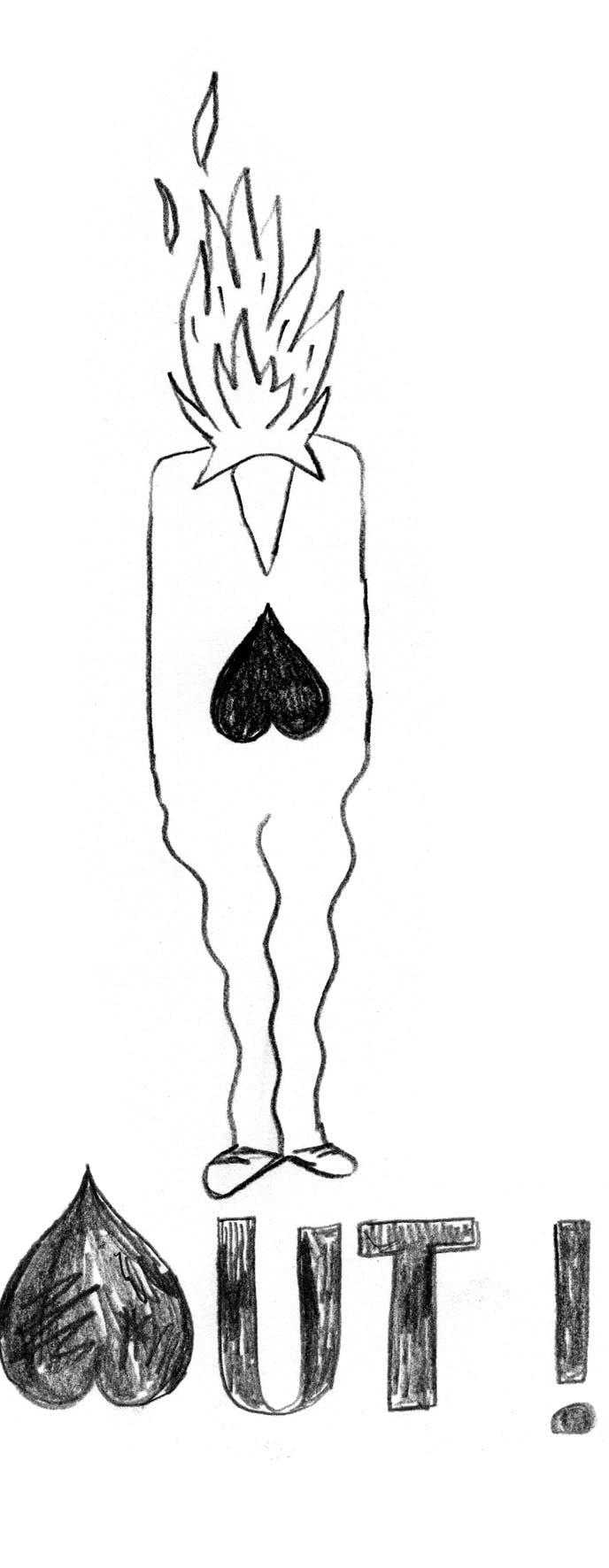
Burn-out : un signal pour repenser nos manières de vivre et de travailler
Le burn-out n’est pas qu’un drame individuel : c’est un signal pour repenser nos rythmes, nos organisations et notre rapport au travail.
mai 2025



mai 2025

Dans l'article précédent , je posais une question : et si le burn-out n’était pas qu’un problème individuel, mais le symptôme d’une société à bout de souffle ?
Je me suis posé la question de ce que disent les chiffres sur le sujet, dans le monde et aussi au Luxembourg.
Ces chiffres ne sont pas que des statistiques froides.
Ils racontent des vies bousculées, des équipes fatiguées, des organisations fragilisées.
Bref, un vrai tsunami silencieux.
Vous découvrez ci-dessous que le nombre de cas de burn-out au Luxembourg n'est pas connu (et pas répertorié). Les chiffres dont nous disposons sont des enquêtes qui mesure des symptômes ou des plaintes mais pas le nombre de personnes en arrêt de maladie pour cause de burn-out.
Approfondissons et regardons les chiffres et les données factuelles à disposition.
Ces discussions sont également en discussion au parlement à Luxembourg (voir fin de l'article)
Et vous ? Combien de cas de burn-out comptez vous dans votre entourage ?

En France, le sujet est vraiment entré dans l’espace public après les vagues de suicides chez Renault et EDF en 2007, puis à France Télécom.
L’année charnière est 2009. Seulement 13 articles entre 2003 et 2009… contre 115 articles entre 2009 et 2015. La médiatisation a suivi l’onde de choc de France Télécom (Chevret-Castellani, 2017).
En Angleterre, une enquête publiée dans The Times (mai 2025) révèle que 85 % des travailleurs ont déjà ressenti des symptômes de burn-out. Presque 1 sur 2 (47 %) a dû s’arrêter pour raison de santé mentale. Mais 1 sur 10 n’a pas osé le dire officiellement.
Les jeunes salariés sont les plus touchés : 91 % des 18-24 ans et 94 % des 25-34 ans disent avoir subi fatigue, brouillard mental ou maux de tête. Cependant, plus d’un quart (26 %) de ceux qui n’ont jamais pris de congé déclarent qu’ils auraient dû le faire mais s’en sont abstenus, par crainte du jugement, surcharge de travail ou raisons financières.
L’étude souligne également un écart générationnel : près de 20 % des 55-64 ans considèrent que la santé mentale doit rester hors du cadre professionnel, contre seulement 8 % des 25-34 ans.
Pour les auteurs de cette étude, ces chiffres démontrent l’urgence de mettre en place de véritables politiques de prévention et d’accompagnement, au-delà du simple discours, car il s’agit non seulement d’un enjeu de bien-être individuel mais aussi d’un enjeu business majeur affectant productivité, rétention et satisfaction des employés.
À l’échelle mondiale, une étude McKinsey (2022, 15 000 salariés interrogés dans 15 pays)
Cette enquête révèlent que :

Le document qui fait généralement référence sur le sujet est l'enquête faite par Gallup qui présente un rapport annuel sur l'état du milieu de travail mondial, qui analyse la perception des employés concernant leur travail et leur vie. En 2024, il met en lumière une détérioration de la santé mentale chez les employés, attribuant une part significative de ce problème à de mauvaises pratiques de gestion et à un manque d'engagement. Le rapport examine l'impact de facteurs économiques et politiques, tels que la situation du marché de l'emploi et les lois sur les droits du travail, sur le bien-être des travailleurs et leur engagement. Enfin, il souligne le rôle crucial des managers dans la promotion de l'engagement des employés et de leur épanouissement global, suggérant que des pratiques de gestion améliorées peuvent réduire le stress et augmenter la productivité.
Prévalence du burnout chez les dirigeants : Un quart des dirigeants se sentent épuisés souvent ou toujours, et deux tiers d'entre eux le ressentent au moins parfois.
Stress chez les employés : 41% des employés déclarent ressentir "beaucoup de stress". Ce stress varie considérablement selon la gestion des organisations :
Causes du stress professionnel : Une cause majeure du stress au travail est le manque de matériel et d'équipement nécessaires pour effectuer le travail efficacement. La perception que les organisations investissent dans des domaines autres que ce dont les employés ont besoin pour accomplir leur travail peut également exacerber le stress.
Solutions inefficaces et efficaces :
Impact du stress et du désengagement : Les employés qui n'aiment pas leur travail ont tendance à avoir des niveaux élevés de stress et d'inquiétude quotidiens, ainsi que des niveaux élevés de toutes les autres émotions négatives. Être activement désengagé au travail est équivalent ou pire que d'être au chômage pour de nombreux indicateurs de bien-être (stress, colère, inquiétude, solitude).
Le rapport souligne que l'amélioration des pratiques de gestion est cruciale non seulement pour l'engagement des employés, mais aussi pour leur bien-être mental et la réduction du burnout et du stress.

Je me suis intéressé à la question du nombre de cas de burn‑out au Luxembourg.
J’ai commencé par consulter l’étude « Quality of Work Index Luxembourg », qui est pertinente car elle mesure un « indice de risque de burn‑out » et d’autres facteurs de risque, mais ne fournit pas de données sur le nombre réel de cas diagnostiqués ou déclarés
Elle permet toutefois de dégager des tendances :
(*) C’est un indicateur statistique de tendance, construit pour suivre l’évolution du risque perçu au Luxembourg depuis 2014. C'est donc une mesure de comparaison pour évaluer les risques d'une année sur l'autre. Les auteurs de l'enquête ne précisent pas si le l'indice de 33,7 est un niveau de risque faible, modéré ou élevé. Ce que nous pouvons en dire c'est que l'indice est en croissance depuis 2014.
Attention : ressentir des symptômes ne veut pas forcément dire être en burn-out.
Les enquêtes mesurent les symptômes et les facteurs aggravants… pas le nombre exact de cas en arrêt de maladie ou de personnes encore au travail mais avec des symptômes ayant un impact négatif sur leur santé.
Déterminer le nombre exact de cas avérés est plus complexe : certaine personnes continuent à travailler malgré des symptômes parfois sévères, par exemple un ancien collègue voisin, directeur des opérations dans une grande banque française a découvert son burnout quand son médecin le lui a annoncé son diagnostic. D’autres personnes sont en maladie après quelques symptômes. Mon article « suis-je en burnout, "quels sont les signaux à repérer" développe ce point.
Les résultats montrent un écart marqué entre différentes catégories de salariés. Les cadres et les télétravailleurs bénéficient globalement de meilleures conditions, tandis que les salariés soumis à des horaires atypiques, ceux du commerce, des transports, de l’hôtellerie-restauration ou encore des professions élémentaires affichent les scores de qualité de travail les plus faibles. Les ressources positives au travail, comme la coopération entre collègues, l’autonomie ou encore l’accès à la formation continue, diminuent. Autre signal d’alerte : les risques physiques pour la santé, en baisse depuis plusieurs années, repartent à la hausse en 2024.
Côté santé, l’étude révèle que 51 % des salariés rapportent une souffrance psychique accrue ou élevée. Les femmes, les 25-44 ans et les parents isolés apparaissent particulièrement vulnérables. Le sommeil est lui aussi fragilisé : un quart des répondants souffre de troubles importants, avec une moyenne de 6h40 par nuit, bien en dessous des recommandations. L’indice de risque de burnout diminue légèrement en 2024 mais reste supérieur à son niveau de 2014. Quant aux pensées suicidaires, elles concernent encore 5 % des salariés "parfois" et 1 % presque quotidiennement. Enfin, le présentéisme est très marqué : les salariés travaillent en moyenne 12 jours par an en étant malades, contre 5 jours d’absence pour maladie.
L’étude s’attarde aussi sur la consommation de substances. Un salarié sur quatre fume et 13 % sont exposés au tabagisme passif sur leur lieu de travail. Près de la moitié (49 %) présente un risque modéré à élevé d’abus d’alcool, et 14 % déclarent avoir déjà bu au travail ou pendant les pauses. On note également une prise non négligeable de médicaments sans prescription (5 %) et, plus marginalement, une consommation de cannabis (0,5 %) ou d’autres drogues (0,3 %) au travail.
cette enquête révèle une stagnation, voire une dégradation continue de la qualité du travail et du bien-être au Luxembourg, avec une hausse des risques physiques et psychiques. Les inégalités se creusent entre catégories de salariés, et la prévention en entreprise reste largement insuffisante.
Ne trouvant pas le nombre de cas diagnostiqués en burnout ou en arrêt de travail pour cause d'épuisement, je me suis tourné vers des professionnels de la santé, qui m’ont orienté vers les sites du ministère de la Santé et du Travail.
Mais là encore, aucune information chiffrée sur le nombre de cas n’apparaît. Il y a un manque de données actuellement et la question de l’identification officielle des cas de burn‑out est en discussion au niveau parlementaire, un chantier en cours cet été.
J’ai donc décidé de me tourner vers le terrain en sondant des RH. J’entends de leur part un chiffre annuel entre 2 à 4 % de salariés absents pour cause de burnout. Maintenant ils me disent « ne pas savoir si c’est le fait de l’organisation ou lié à une cause personnelle, si c’est un burnout ou si c’est une dépression ou si c’est un salarié mécontent qui s’est mis en maladie ».
Bref « tout le monde » parle de burnout mais il n’y a pas de chiffres officiels.
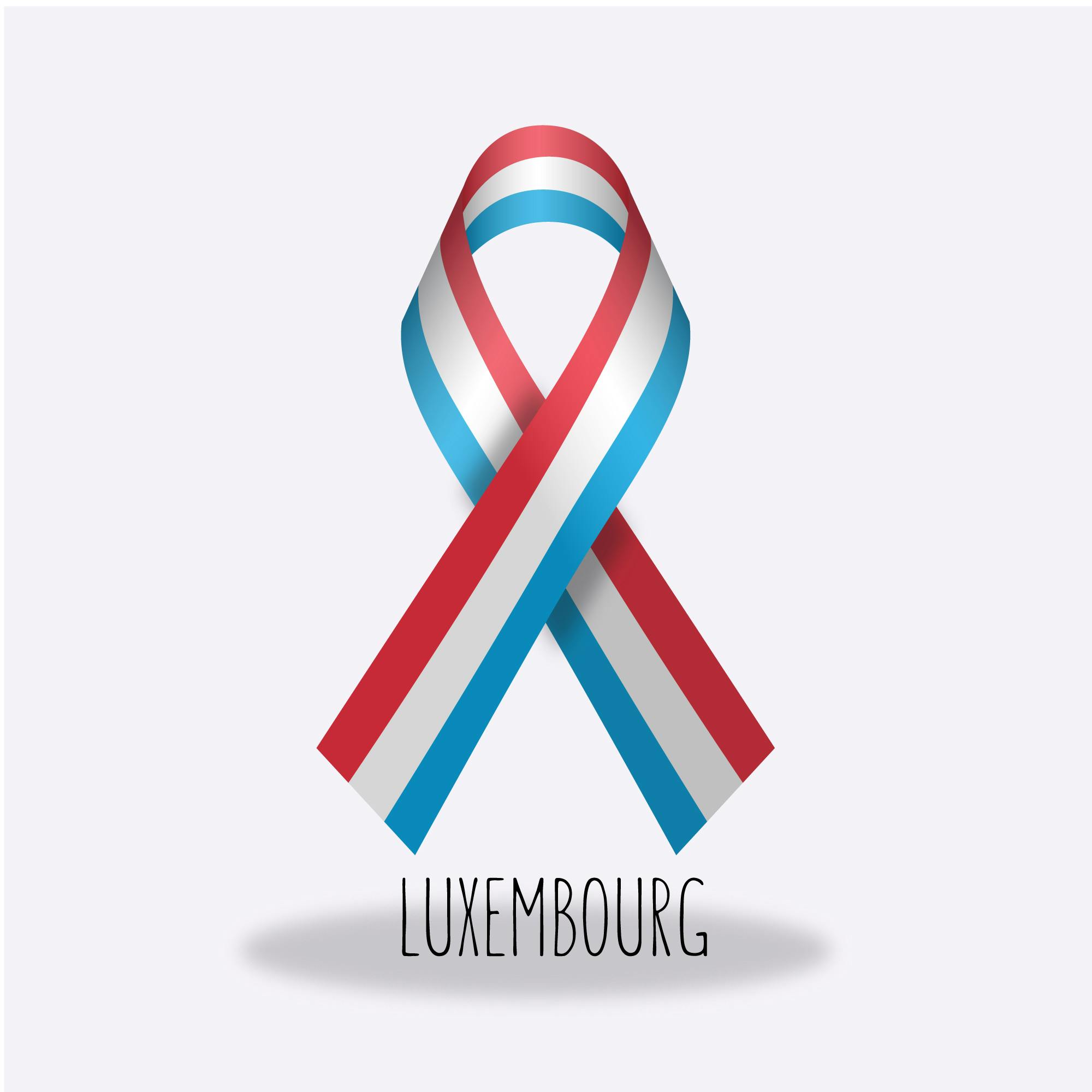
La députée Nathalie Morgenthaler (CSV) interpelle la ministre de la Santé, Martine Deprez, au sujet de l’augmentation des maladies psychiques au Luxembourg, et plus particulièrement du burn-out. (Question parlementaire n°2635 : déposée le 22 juillet 2025 )
Elle rappelle que, selon l’OMS, le burn-out n’est pas reconu comme une maladie mais comme un phénomène lié au travail (ICD-11). Au Luxembourg non plus, il n’est pas classé comme maladie reconnue.
Elle demande donc au gouvernement de fournir :
Aujourd’hui, il n’existe aucun code médical spécifique pour le burn-out. Résultat : il est souvent enregistré sous le terme « dépression », ce qui empêche d’avoir des chiffres fiables sur le nombre de cas, l’évolution ou la durée des arrêts maladie.
Bonne nouvelle malgré tout : même sans code propre, les conséquences médicales (comme une dépression associée) sont bien prises en charge par la CNS.
Côté reconnaissance officielle, la ministre rappelle la définition du burn-out donnée par l’OMS et qu'il n’est pas reconnu comme maladie professionnelle, et aucune réforme n’est prévue à ce stade.
Enfin, pas d’étude nationale spécifique en vue, mais des initiatives pilotes existent. Le programme Lighthouse, par exemple, a déjà accompagné 35 personnes en 2024, avec un suivi médical, psychologique, de la sophrologie et des groupes de parole.
Donc le Luxembourg ne dispose pas de données précises sur le burn-out faute de code spécifique, n’envisage pas sa reconnaissance comme maladie professionnelle, et ne prévoit pas d’étude nationale, mais soutient des projets pilotes tels que Lighthouse
ll serait intéressant d'interroger plus en profondeur les raisons ou arguments avancés par les autorités contre cette reconnaissance (au-delà de la possibilité de classer les symptômes sous d'autres diagnostics existants), et aussi les implications pratiques de cette position pour les salariés et les employeurs.
Il serait aussi intéressant de connaître les conclusions des programmes pilotes Lighthouse. Avec leur recul d'accompagnement, comment se positionnent-ils par rapport à cette non-reconnaissance ?

Que dit l'OMS par rapport à la non reconnaissance du burnout comme maladie ?
Le burn-out n’est pas reconnu comme une maladie par l’OMS car :
Je pense que cette position devrait évoluer avec le temps car bien que le burnout ne soit pas considéré comme une maladie, il est de plus en plus présent dans nos sociétés et il est également associé à des symptômes négatifs pour la santé cérébrale, tels que l'anxiété ou la dépression, qui peuvent à leur tour être liés à des affections de santé mentale plus graves.

Etant donné que de plus en plus de cas d’épuisement sont révélés et amène à des arrêts maladies ou à des mal-êtres au travail, est ce normal qu'il n'y ai pas de reconnaissance officielle du burnout ?
La réponse n'est pas simple. L’apparition d’une maladie, c’est toujours lié à des causes multi-facettes. Le burn-out apparait dans des conditions particulières au travail. Ces conditions vont créer une souffrance qui peuvent déboucher sur des troubles anxieux ou dépressifs.
Par exemple une personne dont l’épuisement au travail a amené une dépression et c’est à cette occasion que des troubles bipolaires se sont manifestés. Dans cet exemple c’est l’épisode dépressif qui est inaugural d’une pathologie psychiatrique mais est ce la cause ? La seule cause ? Surement que non, on sait bien que pour des pathologies psychiatriques il y a un déterminisme génétique mais aussi un impact important de l’environnement.
Donc ces événements de vie difficiles (j’entends ici l’épuisement au travail) vont participer à déclencher et à révéler cette vulnérabilité.
Peut être est-ce pour cela que c’est compliqué de légiférer et d’avoir une reconnaissance de cette pathologie professionnelle ?
Mais c’est un débat qui mérite d’être ouvert.
Je vous laisse vous faire votre opinion en parcourant l'article qui décrit les différentes causes et sources du burn-out . La conclusion est que c'est majoritairement les facteurs organisationnels et la qualité du management qui jouent un rôle sur la sécurité psychologique ou son inverse, l'épuisement organisationnel. Cela n'exclut pas les facteurs personnels et la responsabilité individuelle.

Face à ces chiffres, une question s’impose : et vous, qu’avez-vous envie de changer au sein de votre environnement de travail ? De quelle culture avez vous besoin pour bien remplir votre fonction ? Et dans votre propre vie personnelle ?
Le burn-out n’est pas une fatalité, mais un signal qui invite à agir autrement.
Avant d'examiner les possibilités concrètes dans vos équipes et au niveau individuel, il est essentiel de comprendre précisément ce que recouvre le terme "burn-out". Plongez dans l'analyse pour en saisir la définition et le distinguer du "bore-out".
Lire plus:
Qu'est ce que le burn-out ? Les visages de l'épuisement

Vous avez aimé cet article ?
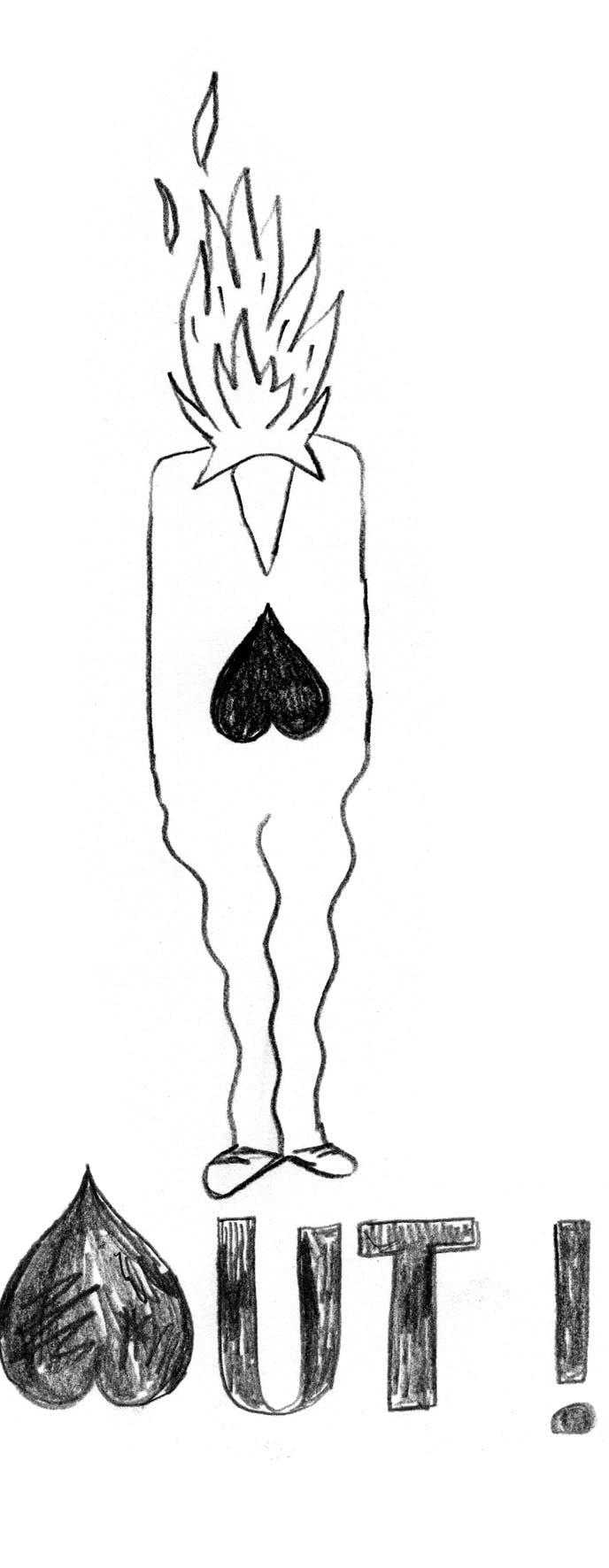
Le burn-out n’est pas qu’un drame individuel : c’est un signal pour repenser nos rythmes, nos organisations et notre rapport au travail.
mai 2025

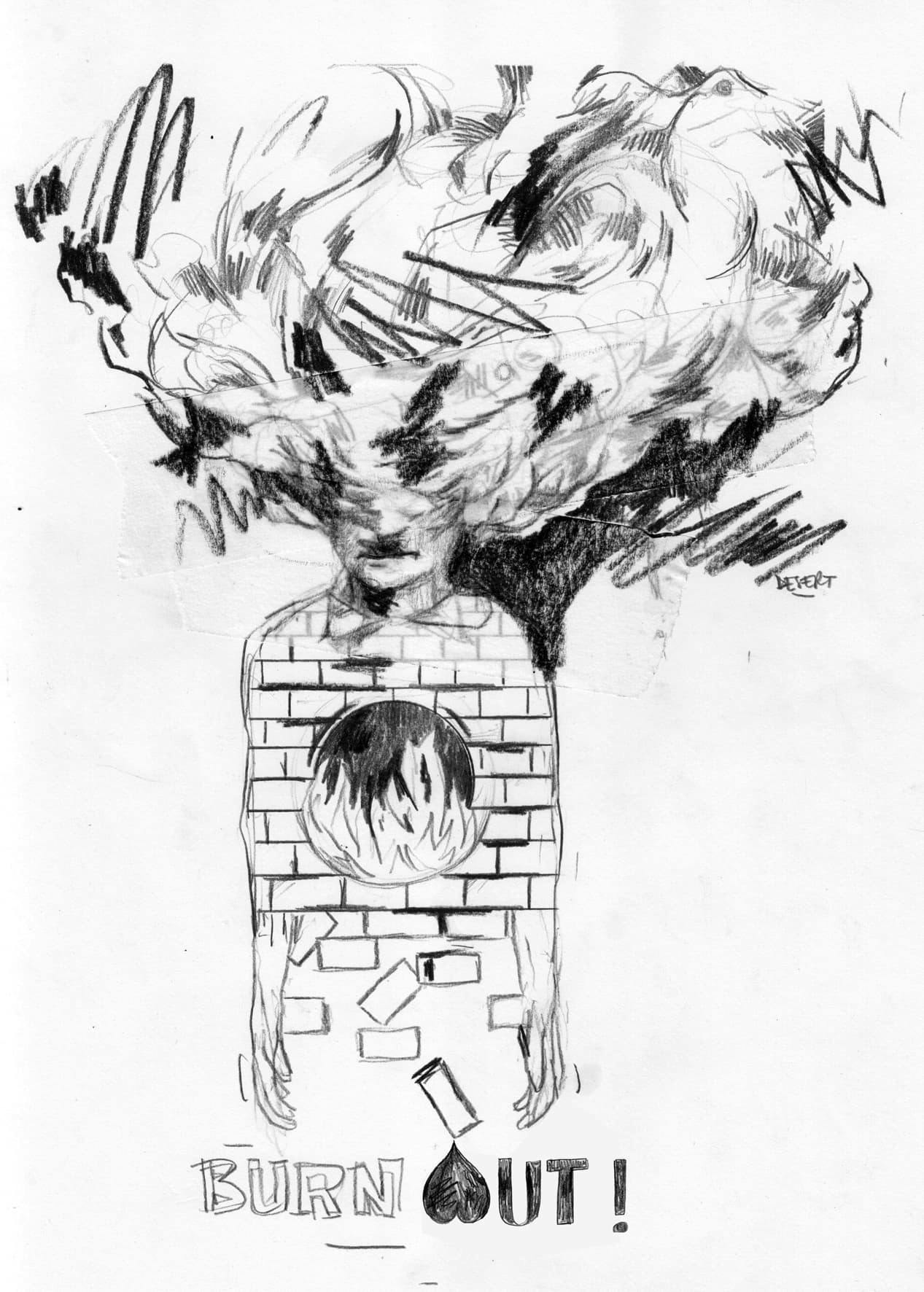
Pas de chiffres officiels au Luxembourg, mais des enquêtes alarmantes. OMS, Gallup, McKinsey, débats au Parlement : que disent vraiment les données ?
mai 2025


Qu’est-ce que le burn-out ? Définition claire, signes à repérer et témoignages vécus pour comprendre l’épuisement professionnel et mieux le prévenir.
mai 2025
